Les normes du domaine de la mission et de la gouvernance partenariale simplifiées
November 6, 2025
Au cœur de la théorie du changement du B Lab [en anglais] réside une idée simple, mais puissante : les entreprises devraient exister pour générer des bénéfices, mais aussi pour avoir un impact positif et significatif sur les personnes et la planète. Le domaine de la mission et de la gouvernance partenariale [en anglais] est le pilier fondamental qui rend cette réalité possible, en demandant aux entreprises de s’ancrer dans une mission clairement définie et de donner à toutes les parties prenantes une place centrale dans les décisions.
Pendant des décennies, la gouvernance d’entreprise a été façonnée par la primauté des actionnaires, c’est-à-dire la croyance que la seule responsabilité d’une entreprise est de maximiser les gains de ses propriétaires. Cette approche restrictive a contribué à aggraver les crises actuelles, des perturbations climatiques aux inégalités sociales. Les nouvelles normes du B Lab sont conçues pour aider les entreprises à abandonner ce modèle obsolète.
En pratique, cet objectif implique qu’une entreprise doit aller au-delà et faire plus que publier des valeurs nobles. Elle doit :
- établir une raison d’être publique visant à générer un impact positif significatif (MGPP 1);
- tenir compte des impacts sur les parties prenantes dans les processus décisionnels (MGPP 2);
- disposer de procédures appropriées pour traiter les réclamations des parties prenantes (MGPP 3);
- adopter des pratiques responsables en matière de marketing et de communication (MGPP 4);
- veiller à ce que sa plus haute instance dirigeante supervise et prenne en compte l’impact et les considérations des parties prenantes (MGPP 5);
- être transparente quant à ses performances sociales et environnementales (MGPP 6).
Toutes les exigences ne s’appliquent pas à chaque entreprise. Une petite entreprise ne doit éventuellement que définir une raison d’être publique et proposer un mode de transmission de base pour les réclamations. Il est en revanche attendu des entreprises plus grandes ou plus complexes qu’elles aillent plus loin et qu’elles mettent en place des processus de supervision au niveau du conseil d’administration, des mécanismes d’engagement officiel des parties prenantes et des dispositifs pour publier publiquement des rapports détaillés.
Une fois mises en œuvre, ces pratiques contribuent à assurer qu’une entreprise exerce ses activités en harmonie avec la mission qu’elle a publiée, qu’elle se montre responsable à l’égard des personnes et des communautés qu’elle touche et qu’elle participe à la création d’une économie plus inclusive, équitable et régénératrice. De cette façon, la « prospérité » n’est plus seulement financière, mais aussi sociale, environnementale et humaine.
MGPP 1 : Établir une raison d’être publique
La première exigence du domaine de la mission et de la gouvernance partenariale impose à toutes les entreprises d’établir publiquement leur raison d’être, soit une mission visant à avoir un impact positif et significatif. Cette obligation s’applique à toutes les entreprises, qu’elles soient des microentreprises, des entreprises sans employé.e.s ou des sociétés comptant parmi les plus grandes multinationales.
En formulant leur mission clairement et stratégiquement, ainsi qu’en la déclarant publiquement, les entreprises créent les bases de tout ce qui s’en suit en matière de gouvernance partenariale. Une raison d’être publique est une boussole pour la stratégie et le point de départ de la responsabilisation, en plus de déterminer le contexte dans lequel les parties prenantes seront ultérieurement impliquées.
MGPP 1.1 : Établir une raison d’être publique
Dès l’obtention de la certification (l’année 0), toutes les entreprises sont tenues d’adopter et de publier une déclaration de mission qui doit respecter les critères suivants :
- Définir un impact positif précis : la déclaration doit déterminer la contribution significative que l’entreprise compte apporter à la société, à l’environnement ou aux deux.
- Établir un lien avec la stratégie de l’entreprise : la déclaration doit confirmer que la mission a une pertinence commerciale claire et qu’elle est intégrée dans les activités et dans les plans de croissance.
- Être rendue publique : la mission doit être publiée (généralement sur le site Web de l’entreprise) afin qu’elle soit transparente pour toutes les parties prenantes.
- Être officiellement soutenue : la mission doit avoir obtenue l’approbation de la plus haute instance dirigeante de l’entreprise.
Le but est d’assurer que toutes les entreprises disposent d’une déclaration de mission à caractère exécutoire, qui est conforme aux exigences normatives B Corp, ancrée dans la stratégie et soutenue par la plus haute instance dirigeante. Bien formulée, cette déclaration n’énonce pas seulement la raison pour laquelle l’entreprise existe, mais aussi la manière dont les décisions seront prises, les parties prenantes impliquées, et l’impact mesuré au fil du temps.
MGPP 2 : Tenir compte des impacts sur les parties prenantes dans les processus décisionnels
Au cœur de la gouvernance partenariale réside une idée simple : les entreprises doivent soupeser les intérêts de toutes les parties prenantes qu’elles touchent, c’est-à-dire ceux de leurs actionnaires, mais aussi ceux de leurs collaboratrices et de leurs collaborateurs, de leurs client.e.s, des communautés, de l’environnement et au-delà.
Les normes MGPP 2 mettent cette idée en pratique en imposant aux entreprises de créer des mécanismes d’engagement des parties prenantes, de formaliser les politiques en matière de gouvernance, d’identifier les enjeux les plus importants, de fixer des objectifs significatifs et de prendre des décisions financières en toute transparence.
MGPP 2.1 : Créer des mécanismes d’engagement des parties prenantes
Pour les microentreprises, les PME et les entreprises sans employé.e.s, la prise en compte de l’intérêt des parties prenantes doit être intégrée dans les processus décisionnels dès le début. Les grandes entreprises doivent respecter cette attente en mettant en place des politiques formelles (voir la norme MGPP 2.2). Cependant, les entreprises plus petites peuvent adopter des mécanismes plus légers qui conviennent à leur taille.
Afin de respecter cette norme, les entreprises doivent :
- Identifier et classer par ordre de priorité les parties prenantes : elles doivent cartographier les personnes et les groupes les plus touchés par leurs activités, telles que le personnel, la clientèle et les prestataires.
- Impliquer les parties prenantes dans les processus décisionnels : elles doivent mettre en place des mécanismes pour collecter leurs avis, qu’il s’agisse de sondages, de groupes consultatifs, de consultations ou de boucles de rétroaction régulières.
- Assurer une large représentation des parties prenantes : elles doivent spécifiquement inclure le personnel, la clientèle, les prestataires, les investisseuses et les investisseurs, les communautés locales ainsi que l’environnement dans une forme d’engagement, au minimum.
MGPP 2.2 : Adopter une politique de gouvernance partenariale
Cette exigence s’applique aux grandes, très grandes (X) et très très grandes (XX) entreprises dès la première année de la certification. Ces entreprises doivent adopter une politique de gouvernance partenariale formelle, approuvée par la plus haute instance dirigeante.
Afin de respecter cette exigence, la politique doit respecter les critères suivants :
- Définir le modèle de gouvernance partenariale : elle doit présenter ce que cela signifie pour l’entreprise d’exercer ses activités en donnant une place centrale aux groupes qu’elle touche.
- Cartographier et classer par ordre de priorité les parties prenantes : elle doit déterminer les ensembles de groupes concernés par les activités de l’entreprise et clarifier ceux qui sont les plus touchés.
- Expliquer le processus décisionnel : elle doit décrire comment les dirigeant.e.s tiennent compte en pratique des impacts positifs et négatifs sur les parties prenantes.
- Établir des mécanismes d’engagement : elle doit préciser la façon dont les groupes concernés sont régulièrement consultés ou représentés.
- Décrire la valeur créée : elle doit dépeindre la manière dont l’entreprise tient compte des intérêts des parties prenantes lorsqu’elle produit des résultats et des avantages.
MGPP 2.3 : Réaliser régulièrement des analyses de matérialité
Les grandes, très grandes (X) et très très grandes (XX) entreprises doivent aussi effectuer régulièrement des analyses de matérialité. Il s’agit d’études exhaustives visant à identifier les enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernance les plus importants pour l’entreprise et ses parties intéressées. Ces évaluations doivent être réalisées au minimum tous les 36 mois, avec un examen intermédiaire entre deux analyses complètes.
Afin d’être conforme, l’analyse doit répondre aux critères suivants :
- Impliquer les principaux groupes : le personnel, la clientèle, les prestataires, les investisseuses et les investisseurs, les communautés locales, et l’environnement doivent être impliqué.e.s dans l’analyse.
- Traiter les enjeux essentiels : elle doit couvrir les questions liées à l’environnement et aux droits de la personne, ainsi que toutes autres préoccupations soulevées par les parties prenantes.
- Appliquer une double matérialité : elle doit aller au-delà des risques financiers pour englober les impacts réels sur les personnes et la planète.
- Être supervisée par le conseil d’administration : le processus de l’analyse et les résultats doivent être passés en revue par la plus haute instance dirigeante.
- Être accessible au public : les résultats doivent être communiqués en toute transparence, souvent sous la forme d’une matrice ou d’un rapport récapitulatif.
MGPP 2.4 : Fixer des objectifs pour les enjeux matériels non couverts par les normes
Lorsqu’une analyse de matérialité met en évidence des enjeux significatifs qui ne sont pas couverts par les normes du B Lab, les grandes, très grandes (X) et très très grandes (XX) entreprises doivent fixer des objectifs clairs pour y remédier. Ces enjeux reflètent souvent des préoccupations propres au secteur d’activités, à la région ou aux parties prenantes (par ex. : la confidentialité des données dans le secteur de la technologie, l’utilisation de l’eau dans l’agriculture ou la qualité de l’air dans les zones confrontées à une pollution élevée).
Afin d’être conforme, le processus doit répondre aux critères suivants :
- Fixer des objectifs SMART : au minimum, un objectif spécifique, mesurable, approprié, réaliste et temporel doit être défini pour chaque enjeu matériel non couvert par les normes.
- Intégrer les objectifs dans la stratégie : les objectifs doivent être incorporés dans le plan d’affaires de l’entreprise plutôt que de les gérer comme des projets secondaires.
- Obtenir l’approbation du conseil d’administration : la plus haute instance dirigeante doit passer en revue et soutenir les objectifs fixés.
- Publier et rendre compte des progrès : les objectifs doivent être rendus publics et des mises à jour sur les progrès réalisés doivent être publiées tous les ans.
- Renouveler les engagements : lorsqu’un objectif a été réalisé, l’entreprise doit en fixer un nouveau qui répond aux mêmes critères.
MGPP 2.5 : Prendre en compte les parties prenantes dans les décisions concernant les dividendes et les rachats d’actions
Pour les très très grandes (XX) entreprises, des responsabilités supplémentaires s’appliquent à partir de la troisième année de la certification (année 3). Les décisions concernant les dividendes et les rachats d’actions doivent tenir compte des impacts sur les parties prenantes ainsi que des intérêts des actionnaires.
Afin d’être conforme, le processus doit répondre aux critères suivants :
- Tenir compte de toutes les parties intéressées : les entreprises doivent démontrer comment le personnel, la clientèle, les prestataires, les investisseuses et les investisseurs, les communautés et l’environnement ont été pris.e.s en compte dans les décisions concernant les dividendes et les rachats d’actions.
- Concilier les intérêts concurrents : les entreprises doivent consigner la manière dont les divergences en matière de besoins ont été examinées et résolues.
- Assurer la transparence : les entreprises doivent être en mesure d’expliquer comment elles ont soupesé les décisions concernant la répartition des bénéfices par rapport au réinvestissement dans les performances sociales et environnementales.
Cette disposition s’attaque à l’une des formes d’expression les plus claires de la primauté des actionnaires : distribuer les bénéfices sans tenir compte de l’impact à long terme. En exigeant la prise en compte des parties prenantes dans l’allocation des capitaux, les normes contribuent à rediriger le pouvoir financier vers la création d’une valeur à long terme pour les personnes et la planète.
Prises ensemble, les exigences des normes MGPP 2 permettent d’assurer que les parties prenantes ne font pas l’objet de considérations de second plan, mais qu’elles constituent une partie intégrale de la gouvernance. Que cela soit au moyen de simples modes de rétroaction dans les petites entreprises ou d’analyses et de politiques formelles dans les plus grandes sociétés, ces pratiques garantissent que les décisions commerciales tiennent compte de leur impact plus large.
En intégrant les voix des parties prenantes dans leur fonctionnement global, de la stratégie à l’allocation des capitaux, les entreprises modifient la définition de « prospérité », la transformant de « gains des actionnaires à court terme » en « valeur à long terme pour le bien public et le monde naturel ».
MGPP 3 : Traiter les réclamations des parties prenantes

Si les normes MGPP 1 visent à établir la mission de l’entreprise et les normes MGPP 2 à intégrer toutes les parties concernées dans le processus décisionnel, les normes MGPP 3 ont pour but d’assurer que les parties prenantes disposent également de mécanismes pour soulever des préoccupations.
Une procédure de réclamation est essentielle à la responsabilisation. Elle fournit au personnel, aux communautés et aux autres groupes une méthode sûre et transparente pour signaler des problèmes, et elle engage les entreprises à les résoudre. Sans de tels systèmes, même les entreprises les mieux intentionnées courent le risque d’ignorer des enjeux ou d’éroder la confiance des parties prenantes.
MGPP 3.1 : Disposer d’une procédure de réclamation accessible au public
Les microentreprises, les PME et les entreprises sans employé.e.s doivent mettre en place une procédure de réclamation simple et accessible à tout le monde dès l’obtention de la certification, soit l’année 0. Le fait de disposer de procédures pour signaler officiellement des réclamations, qu’elles proviennent d’employé.e.s, de client.e.s ou de toutes autres parties touchées par les activités de l’entreprise, permet de garantir que les parties prenantes savent quelle démarche suivre si les choses ne se déroulent pas bien et que leurs préoccupations seront sérieusement prises en compte. (Il faut noter que les sociétés plus grandes doivent en revanche aller plus loin en vertu de la norme MGPP 3.3. Elles doivent rendre les procédures plus largement accessibles et impartiales, ainsi que les communiquer de façon formelle aux parties prenantes.)
Afin d’être conforme, la procédure doit répondre aux critères suivants :
- Mettre à disposition des canaux de transmission accessibles : les entreprises peuvent publier un formulaire de réclamation en ligne ou fournir un autre moyen facilement accessible pour soulever des préoccupations.
- Définir les attentes : les entreprises doivent expliquer les critères de recevabilité d’une réclamation, les étapes du processus et les délais de réponse.
- Protéger les lanceuses et les lanceurs d’alerte : les entreprises doivent décrire les protections contre les représailles envers les personnes qui manifestent des préoccupations.
- Fermer la boucle : les entreprises doivent tenir au courant les réclamant.e.s des avancées du processus de résolution ou expliquer les raisons pour lesquelles une réclamation n’a pas été acceptée.
MGPP 3.2 : Assurer le suivi et attribuer les responsabilités
Les microentreprises et les PME doivent également assurer le suivi des réclamations et attribuer la responsabilité de les résoudre dès l’année 0 de la certification. Cette étape garantit que les problèmes ne passent pas entre les mailles du filet, mais qu’ils sont activement surveillés, gérés et résolus.
Afin d’être conforme, le processus doit répondre aux critères suivants :
- Surveiller et résumer les réclamations : les entreprises doivent conserver des registres annuels des réclamations, y compris leur état et leur objet.
- Assigner la responsabilité : les entreprises doivent nommer un.e responsable parmi le personnel pour traiter les réclamations.
- Prouver les résolutions : les entreprises doivent présenter des preuves de la clôture des réclamations; et si aucune réclamation n’a été reçue, elles doivent démontrer qu’un processus approprié a été mis en place.
MGPP 3.3 : Rendre les procédures accessibles à toutes les parties prenantes
Pour les grandes, très grandes (X) et très très grandes (XX) entreprises, les procédures de réclamation doivent respecter des normes plus élevées en matière d’accessibilité. Cette exigence vise à refléter leur empreinte plus large, car elles comptent un plus grand nombre de parties prenantes, dans davantage d’endroits et avec des besoins plus diversifiés.
Afin d’être conforme, la procédure doit répondre aux critères suivants :
- Être accessible à grande échelle : les entreprises doivent publier la procédure dans les langues et les formats pertinents pour permettre à toutes les parties prenantes de l’utiliser.
- Éviter les conflits d’intérêts : les entreprises doivent expliquer comment le processus décisionnel des réclamations demeurera impartial.
- Aviser les parties prenantes : les entreprises doivent informer proactivement les principaux groupes de parties prenantes de la procédure.
- Suivre un processus équitable : les entreprises doivent respecter les mêmes exigences en matière de transparence, de protection et de résolution que celles décrites dans la norme MGPP 3.1.
MGPP 3.4 : Rendre compte des réclamations à la direction et au public
Pour les grandes, très grandes (X) et très très grandes (XX) entreprises, les procédures de réclamation doivent également inclure des mécanismes de supervision et de déclaration publique. Cette exigence intègre la supervision des réclamations dans le mandat de la direction, soulignant son importance pour l’intégrité de l’entreprise.
Afin d’être conforme, le processus doit répondre aux critères suivants :
- Élaborer des rapports annuels : les entreprises doivent analyser les réclamations reçues, évaluer l’efficacité des procédures et recommander des améliorations.
- Impliquer la direction : les entreprises doivent veiller à ce que les rapports soient passés en revue par la plus haute instance dirigeante.
- Communiquer les résultats publiquement : l’entreprise doit divulguer les résultats des rapports, tels que le nombre et le type de réclamations, les résolutions et les niveaux de satisfaction des parties prenantes.
Le processus de déclaration publique permet d’assurer que les parties prenantes voient que des mécanismes de réclamation existent, mais aussi qu’ils fonctionnent. Ceci signifie que les rétroactions sont réellement prises en compte et mises correctement en contexte, et qu’elles peuvent influencer les pratiques ainsi que les politiques des entreprises à un niveau significatif. Par ailleurs, le travail investi dans la préparation des rapports fournit aux entreprises des données précieuses sur les schémas et les risques récurrents, les aidant ainsi à s’attaquer directement aux causes profondes plutôt que de réagir au cas par cas.
Prises ensemble, les exigences des normes MGPP 3 font des procédures de réclamation un élément de base de la gouvernance partenariale. Elles procurent aux personnes et aux communautés touchées par les actions de l’entreprise un moyen clair pour soulever leurs préoccupations en toute sécurité et avec la certitude qu’elles seront traitées.
En adaptant les attentes selon la taille des entreprises, les normes établissent un équilibre entre accessibilité et rigueur : des procédures simples pour les petites entreprises; des systèmes plus formels et transparents pour les grandes sociétés. Dans chaque cas, l’objectif est le même. Il vise à renforcer la confiance, à empêcher que les préjudices soient ignorés et à faire de la réactivité vis-à-vis des parties prenantes un élément de la définition de la prospérité pour les entreprises.
MGPP 4 : Adopter des pratiques responsables en matière de marketing et de communication
Le marketing et la communication (incluant les relations publiques) façonnent la manière dont le monde perçoit les valeurs et l’impact d’une entreprise. Bien mis en œuvre, ils permettent d’instaurer la confiance et de communiquer les progrès réels. Cependant, lorsqu’ils ne sont pas bien employés, ils risquent d’induire en erreur les parties prenantes ou de contribuer à « l’écoblanchiment », c’est-à-dire lorsque les entreprises exagèrent ou communiquent une fausse image de leurs performances sociales et environnementales.
Les normes MGPP 4 fixent des exigences imposant aux entreprises de commercialiser leurs biens et services de manière responsable, de faire des affirmations exactes et précises, ainsi que de communiquer aux parties prenantes une vision honnête de leurs impacts.
MGPP 4.1 : Établir des principes pour mettre en œuvre un marketing responsable
Les microentreprises et les petites entreprises doivent consigner des principes de base pour orienter les pratiques de marketing et de communication dès l’année 0 de la certification. Ces principes doivent fournir un cadre pour garantir que les affirmations de l’entreprise en matière sociale et environnementale sont crédibles, proportionnées et éthiques.
Afin d’être conforme, l’ensemble des principes doivent répondre aux critères suivants :
- Fonder les affirmations sur des preuves : les principes doivent permettre de garantir que toutes les déclarations en matière sociale et environnementale sont précises, vérifiables et étayées par des données fiables ou scientifiques.
- Être transparents quant à la portée : les principes doivent permettre de communiquer honnêtement à propos des impacts positifs et négatifs, plutôt que de trier sur le volet ou d’exagérer les réalisations.
- Suivre des pratiques éthiques : les principes doivent permettre d’appliquer des normes claires lorsque des canaux de marketing et de communication sensibles sont utilisés.
- Être partagés en interne : les entreprises doivent veiller à communiquer les principes aux employé.e.s et à les rendre facilement accessibles au sein de l’organisation.
MGPP 4.2 : Adopter une politique de marketing responsable
Pour les moyennes, grandes, très grandes (X) et très très grandes (XX) entreprises, les exigences sont plus formelles. Dès l’année 0 de la certification, ces entreprises doivent adopter une politique de marketing et de communication responsables, supervisée par la haute direction ou le conseil d’administration.
Afin d’être conforme, la politique doit répondre aux critères suivants :
- Définir la portée et les publics ciblés : la politique doit décrire l’étendue de sa couverture et s’appliquer à tous les publics de l’entreprise.
- Fixer des exigences à l’échelle de l’entreprise : la politique doit détailler les attentes pour toute personne qui crée du contenu en matière de marketing ou de communication.
- Obtenir l’approbation de la direction : les entreprises doivent s’assurer que la politique est examinée et approuvée par l’équipe de direction ou la plus haute instance dirigeante.
- Exiger des affirmations précises : la politique doit assurer que les affirmations sont exactes, vérifiables et proportionnelles aux actions de l’entreprise.
- Communiquer clairement les impacts : la politique doit permettre de refléter les effets positifs et négatifs des activités de l’entreprise, en utilisant un langage précis et accessible, ainsi que de rendre les communications disponibles dans les langues et les formats pertinents pour les parties prenantes.
- Appliquer des lignes directrices éthiques : la politique doit régir l’utilisation par l’entreprise de canaux et de pratiques sensibles.
- Assigner la responsabilité : la politique doit attribuer la responsabilité de faire respecter la conformité au niveau de l’équipe de direction ou du conseil d’administration.
- Être partagée en interne : les entreprises doivent rendre la politique accessible à l’ensemble des employé.e.s.
Pour les grandes sociétés qui ont une portée et une influence plus étendues, cette exigence garantit la crédibilité de leurs communications en assurant qu’elles reflètent fidèlement leur empreinte sociale et environnementale et tiennent la direction responsable de la manière dont l’entreprise se présente au monde.
Prises ensemble, les exigences des normes MGPP 4 aident les entreprises à éviter les pièges liés à l’exagération des affirmations et à l’écoblanchiment. En rendant l’honnêteté et la proportionnalité non négociables, elles renforcent la confiance des parties prenantes et harmonisent la voix publique des entreprises avec leurs performances réelles.
MGPP 5 : Intégrer la supervision dans la gouvernance et la direction
Pour que la mission et la gouvernance partenariale pèsent vraiment leurs poids, la supervision doit provenir du « sommet » de l’organisation. Les normes MGPP 5 assurent que les conseils d’administration et les équipes de direction surveillent activement la mission et les performances d’une entreprise, lient la responsabilisation aux cibles de la direction et intègrent les objectifs en matière sociale et environnementale dans le tissu des processus décisionnels. Sans ce degré d’implication de la direction, la mission risque de demeurer une déclaration plutôt que de devenir une norme.
MGPP 5.1 : Passer en revue la mission et les performances tous les ans
Dès l’année 0 de la certification, toutes les entreprises ayant des employé.e.s, qu’il s’agisse de petites sociétés ou de multinationales, doivent s’assurer que leur plus haute instance dirigeante examine la mission, les performances et la gouvernance partenariale au minimum une fois par année. Cette évaluation permet de créer un point de vérification régulier au sommet de la hiérarchie de l’organisation, soit au niveau où les membres de la haute direction évaluent si l’entreprise remplit ses engagements.
Afin d’être conforme, l’évaluation doit répondre aux critères suivants :
- Vérifier la concordance avec la mission : la direction doit évaluer les progrès réalisés pour faire avancer la mission publique de l’entreprise (comme définie en vertu de la norme MGPP 1.1).
- Évaluer les performances : la direction doit comparer les résultats obtenus en matière sociale et environnementale par rapport aux objectifs fixés.
- Surveiller la gouvernance : la direction doit examiner la manière dont les intérêts des parties prenantes sont pris en considération dans les processus décisionnels.
MGPP 5.2 : Entériner la supervision dans les responsabilités de la plus haute instance dirigeante
Pour les grandes, très grandes (X) et très très grandes (XX) entreprises, les responsabilités en matière de gouvernance doivent être directement inscrites dans la charte ou le mandat du conseil d’administration. Cette exigence transforme la supervision d’une question de bonne pratique en partie intégrante de la gouvernance.
Afin d’être conforme, la charte doit répondre aux critères suivants :
- Assigner explicitement la responsabilité de la supervision : la charte doit rendre le conseil d’administration responsable de la mission, de l’impact social et environnemental, ainsi que de la gouvernance partenariale.
- Formaliser la responsabilisation : la charte doit permettre d’assurer que ces responsabilités sont clairement définies dans le mandat officiel de l’instance dirigeante.
MGPP 5.3 : Définir des objectifs en matière d’impact pour les membres de la direction
Cette exigence est imposée aux grandes, très grandes (X) et très très grandes (XX) entreprises à partir de la troisième année de la certification. Elle lie directement la responsabilité de la haute direction à l’impact en intégrant les performances sociales et environnementales dans les objectifs de l’ensemble des dirigeant.e.s.
Afin d’être conforme, l’approche adoptée doit répondre aux critères suivants :
- Inclure l’ensemble des cadres dirigeant.e.s : chaque membre de l’équipe de direction doit avoir au minimum un objectif annuel lié aux performances sociales et environnementales.
- Utiliser des objectifs SMART : les objectifs doivent être spécifiques, mesurables, appropriés, réalistes et temporels.
MGPP 5.4 : Lier la rémunération incitative à l’impact
Les grandes, très grandes (X) et très très grandes (XX) entreprises qui offrent déjà une rémunération incitative aux membres de la direction doivent intégrer les objectifs en matière sociale et environnementale dans leurs plans incitatifs à compter de la troisième année de la certification. Cette exigence permet d’assurer que les récompenses financières reflètent bien plus que les bénéfices, mais qu’elles tiennent aussi compte de la manière dont les dirigeant.e.s contribuent à faire avancer les engagements plus larges de l’entreprise.
Afin d’être conforme, l’approche adoptée doit répondre aux critères suivants :
- Intégrer les objectifs dans les évaluations : les entreprises doivent lier les objectifs aux évaluations annuelles du rendement ou aux revues financières.
- Assurer le suivi des récompenses : les entreprises doivent consigner la partie de la rémunération qui est liée aux performances sociales et environnementales.
- Établir des critères SMART : les entreprises doivent veiller à ce que les objectifs liés à l’impact soient concrets et mesurables.
MGPP 5.5 : Élargir la responsabilité des objectifs d’impact aux gestionnaires
Pour les très très grandes (XX) entreprises, à compter de la troisième année, la responsabilisation en matière d’impact doit être étendue au-delà des membres de la direction et transmise en cascade aux gestionnaires. Cette exigence s’applique spécifiquement aux gestionnaires qui sont responsables de personnes et de budgets ou qui ont l’autorité de prendre des décisions. Le fait de tenir ces cadres responsables garantit que les personnes qui traduisent la stratégie en actions quotidiennes sont aussi évaluées en fonction de l’impact.
Afin d’être conforme, l’approche adoptée doit répondre aux critères suivants :
- Inclure l’ensemble des gestionnaires : les entreprises doivent assigner aux gestionnaires au minimum une cible de performance liée aux objectifs sociaux ou environnementaux.
- Consigner les objectifs : les entreprises doivent consigner tous les objectifs liés à l’impact dans le cadre des processus d’évaluation.
- Utiliser des critères SMART : les entreprises doivent établir des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, appropriés, réalistes et temporels.
Le fait d’étendre la responsabilité des objectifs aux gestionnaires permet d’assurer que l’intégrité règne dans l’ensemble de l’entreprise, et pas seulement au sommet de l’organisation. Elle renforce l’idée que la réalisation des objectifs en matière sociale et environnementale est une responsabilité collective, ancrée à chaque échelon de la direction.
Prises ensemble, les exigences des normes MGPP 5 permettent d’assurer que la supervision de la mission, de l’impact et de la gouvernance partenariale n’est pas une tâche annexe, mais qu’elle est intégrée dans les structures de direction. Des examens du conseil d’administration aux objectifs des dirigeant.e.s et des gestionnaires, ces pratiques font concorder l’intendance avec l’autorité. En mettant l’impact sur un pied d’égalité avec les performances financières, les normes MGPP 5 montrent qu’un leadership responsable est un devoir central de la gouvernance moderne.
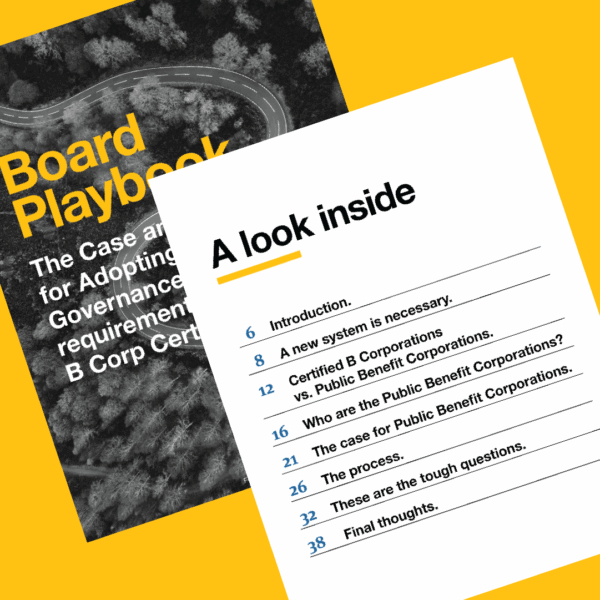
Une nouvelle façon de faire des affaires
Afin d’aider les dirigeant.e.s d’entreprises à adopter le statut de « benefit corporation » (société d’intérêt social) comme condition préalable à la certification B Corp, le B Lab États-Unis et Canada a créé cette ressource téléchargeable, le « Board Playbook » (guide du conseil d’administration) [en anglais], pour présenter le processus et démystifier les risques.
MGPP 6 : Assurer la transparence
L’intégrité ne signifie pas grand chose sans transparence. Les normes MGPP 6 permettent d’assurer que les entreprises communiquent ouvertement à leurs parties prenantes leurs performances sociales et environnementales, en utilisant des rapports crédibles et les rétroactions des employé.e.s pour montrer si les engagements sont respectés dans la pratique. Ces exigences rendent les performances visibles, vérifiables et fiables.
MGPP 6.1 : Rendre compte publiquement de l’impact tous les ans
Cette exigence s’applique aux grandes et aux très grandes (X) entreprises à compter de la troisième année de la certification. Au minimum une fois par an, les entreprises doivent publier un rapport sur leurs performances sociales et environnementales, approuvé par leur plus haute instance dirigeante, et le rendre accessible à toutes les parties prenantes.
Si les entreprises ne préparent pas de rapport annuel complet, elles doivent fournir des mises à jour intérimaires plus légères chaque année (par ex. : des publications sur leur site Web ou des divulgations sur des sujets particuliers) et publier un rapport exhaustif au minimum tous les deux ans.
Pour les très très grandes entreprises, les exigences imposent une rigueur supplémentaire en prescrivant l’utilisation de normes externes pour les rapports (voir la norme MGPP 6.2).
Afin d’être conforme, le rapport doit répondre aux critères suivants :
- Mettre en évidence les progrès : le rapport doit présenter les résultats par rapport à toutes les mesures pertinentes des performances sociales et environnementales de l’entreprise et récapituler les processus d’engagement des parties prenantes.
- Obtenir l’approbation du conseil d’administration : le rapport doit être examiné et approuvé par la plus haute instance dirigeante de l’organisation.
- Être accessible au public : le rapport doit être publié sur le site Web de l’entreprise et être accessible à toutes les parties prenantes.
MGPP 6.2 : Utiliser les normes de déclaration d’une partie tierce
Cette exigence s’applique aux très très grandes (XX) entreprises à compter de la troisième année de la certification. Ces entreprises doivent mettre leur rapport public sur l’impact en conformité avec les normes reconnues d’une partie tierce afin de permettre la cohérence et la comparabilité au fil du temps.
Afin d’être conforme, le rapport doit répondre aux critères suivants :
- Suivre un cadre reconnu : les entreprises doivent s’appuyer sur les normes d’une partie tierce pour établir la structure et les mesures de ses rapports.
- Obtenir l’approbation du conseil d’administration : le rapport doit recevoir l’approbation de la plus haute instance dirigeante avant d’être publié.
- Maintenir la cohérence : le rapport doit être préparé sur une base annuelle et respecter un format qui permet aux parties prenantes de faire le suivi des progrès au fil des ans.
- Présenter des éléments substantiels : le rapport doit couvrir les progrès réalisés par rapport aux objectifs de performance, les actions spécifiques qui ont été entreprises et les stratégies de la direction pour les mettre en œuvre.
MGPP 6.3 : Évaluer la capacité des collaboratrices et des collaborateurs à mettre en œuvre la stratégie
Cette exigence s’applique aussi aux grandes, très grandes (X) et très très grandes (XX) entreprises à partir de la troisième année de la certification. Ces entreprises doivent évaluer périodiquement si leurs effectifs comprennent et sont prêts à mettre en œuvre la stratégie de l’entreprise en matière sociale et environnementale.
Afin d’être conforme, l’évaluation doit répondre aux critères suivants :
- Mesurer la compréhension : l’évaluation doit permettre de jauger dans quelle mesure les collaboratrices et les collaborateurs comprennent la stratégie et les objectifs d’impact de l’entreprise.
- Mettre à l’essai l’état de préparation : les entreprises doivent évaluer si les employé.e.s se sentent prêt.e.s à mettre en pratique la stratégie.
- Recueillir les perspectives : l’évaluation doit saisir comment les employé.e.s perçoivent la mise en œuvre de la stratégie dans les activités quotidiennes de l’entreprise.
- Être réalisée régulièrement : les entreprises doivent mener les évaluations au minimum tous les 24 mois.
- Respecter les choix individuels : les entreprises doivent indiquer clairement que la participation est facultative et consigner les rétroactions, ainsi que les mesures de suivi.
- Permettre la prise de mesures : les entreprises doivent analyser les rétroactions collectées dans le cadre de l’évaluation, puis s’en servir pour élaborer un plan d’action.
En collectant ces rétroactions, les entreprises peuvent identifier les écarts entre les engagements de la direction et la capacité des employé.e.s à les remplir. Cette diligence raisonnable permet d’assurer que les stratégies ne sont pas seulement ambitieuses, mais aussi réalisables.
Prises ensemble, les exigences des normes MGPP 6 créent une culture d’ouverture. Les performances sont déclarées, confirmées selon des normes tierces et renforcées par les rétroactions des employé.e.s. La transparence offre aux parties prenantes la possibilité d’évaluer si une entreprise réalise des progrès. Elle renforce la responsabilisation de la direction et elle permet d’assurer que les stratégies en matière sociale et environnementale sont mises en pratique à tous les échelons de l’entreprise.
Pourquoi la mission et la gouvernance partenariales sont-elles importantes?
Ces six normes définissent ce que cela signifie de diriger avec une mission. Elles traduisent des idéaux en étapes pratiques : définir une mission publique, impliquer les parties touchées par l’entreprise, écouter les préoccupations, communiquer de manière responsable, ancrer la supervision et publier des rapports en toute transparence.
Pourquoi cela compte-t-il? Parce que la crédibilité, la confiance et la véritable responsabilisation sont créées lorsque les entreprises mettent leur mission en pratique. Ces normes s’adaptent d’une façon appropriée à l’échelle des entreprises : une microentreprise peut seulement nécessiter une déclaration de mission et une méthode de réclamation alors qu’on attend des multinationales qu’elles mettent en place une supervision au niveau du conseil d’administration, qu’elles assignent des objectifs aux membres de leur direction et qu’elles rendent accessibles au public des rapports rigoureux.
En respectant les normes du domaine de la mission et des parties prenantes, les entreprises ne se qualifient pas seulement pour obtenir la certification B Corp : elles incarnent également le modèle d’un avenir dans le cadre duquel la prospérité d’une entreprise est évaluée en fonction de ses contributions aux personnes, aux communautés et à la planète. Pour en savoir plus sur la manière dont votre entreprise peut mesurer et améliorer ses performances, consultez l’évaluation B Impact [en anglais].
Copyright : B Lab États-Unis et Canada
Inscrivez-vous à notre newsletter B The Change
Lisez des histoires sur le mouvement B Corp et sur les personnes qui utilisent les entreprises comme une force pour le bien. La newsletter B The Change est envoyée chaque semaine le vendredi.
